L'anti-productivisme : un retour vers le passé ?
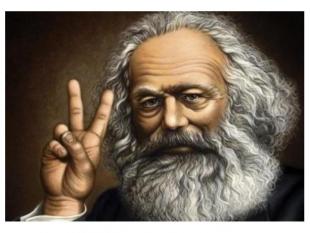
En 1986, James M. Buchanan obtenait le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la «théorie des choix publics» et le comportement des décideurs. Il établissait que, statistiquement, les décideurs économiques cherchent à maximiser leurs intérêts économiques personnels, c'est-à-dire à s'en mettre plein les poches. Il élargissait son observation aux décideurs politiques et administratifs et montrait qu'eux aussi tendaient à maximiser leurs intérêts individuels et non l'intérêt public. Ceux-ci n'ont pas, comme chez les décideurs économiques, des intérêts financiers directs. Les élus cherchent à étendre leurs pouvoirs. Les hauts fonctionnaires cherchent à se rendre -ou à rendre leur administration- incontournable.
Que se passe t-il chez les anonymes, les sans-grades, les non-décideurs ? Eh bien, dans la mesure où les décideurs ne sont pas une espèce différente du reste de l'humanité, on peut raisonnablement supposer que la majorité des individus cherche aussi à maximiser leur intérêt personnel.
Chez les tâcherons, les besogneux, dont le revenu est lié à la productivité, il faut augmenter la production pour augmenter le revenu. Les agriculteurs font partie des besogneux. Ils seront donc poussés vers le productivisme.
Chez les prolétaires non-tâcherons, l'objectif est d'améliorer le bien-être, et en particulier le salaire. Quand on n'est que le maillon interchangeable d'une chaîne de production, l'efficacité passe par l'action collective. Ils sont poussés, non pas vers le productivisme, mais vers ce qu'on nomme communément «lutte des classes».
Attardons-nous un moment sur les classes moyennes, que Karl Marx appelait la petite bourgeoisie. Les besoins et les préjugés de cette petite bourgeoisie ont façonné la politique française. Dans ces classes, les stratégies de maximisation sont plus individualistes, donc plus variées.
Les uns vont faire valoir la capacité de nuisance de leur profession pour obtenir des avantages. Ils ne sont pas productivistes mais corporatistes.
D'autres vont passer d'une entreprise à une autre ou d'un poste à un autre, au gré des opportunités. Ils ne sont pas productivistes, mais opportunistes.
Certains comportements de maximisation des intérêts personnels confinent au vol ou à la prostitution : escroqueries en tous genres, vénalité, promotion-canapé, corruption. On pourrait les taxer, non pas de productivistes, mais de corrompus.
Nous sommes partis de Marx parce que, de toutes les utopies sociales du XIXème siècle, le marxisme est la plus productiviste. Ce productivisme est sous-tendu par une conviction : le travail productif est la source de la richesse collective. Le capital confisque cette richesse, qui s'accumule dans les mains de celui qui détient les outils de production. Il faut rendre la richesse à celui qui la produit.
La critique du productivisme est-elle donc une réflexion sociale anti-marxiste, post-marxiste ou est-ce une régression vers une pensée pré-marxiste ?
La critique du productivisme pourrait correspondre à celle de la société industrielle, lorsqu'on y intègre la limitation des ressources naturelles et la nécessité d'un développement durable. Mais pour que nous ayons affaire à une réflexion sociale post-marxiste, il faut que la critique du productivisme accepte la frugalité comme un corollaire. Les penseurs qui suivent cette voie, comme Pierre Rabhi, sont peu nombreux. J'ai rencontré énormément de gens de gauche qui considèrent que les fruits de la croissance doivent bénéficier à tous, ce qui est conforme à leur idéal partageur. Je n'ai rencontré pratiquement personne pour considérer que les charges de la décroissance doivent être partagées. Pas question pour eux de partager leur revenu avec ceux qui subissent la crise, les besogneux et les chômeurs !
Une critique écologiste du capitalisme, pour être cohérente, ne peut pas se limiter à la dénonciation du productivisme. Elle ne serait qu'une dénonciation des besogneux par la petite bourgeoisie. Drôle de lutte des classes !
La dénonciation des agriculteurs, c'est-à-dire d'une catégorie de travailleurs, révèle que nous ne sommes pas dans une réflexion socialiste. Nous sommes bien loin -et bien en-dessous- des analyses comme celles de Bernard Lambert, agriculteur et auteur de l'ouvrage «Les paysans dans la lutte des classes».
Que signifie alors cette dénonciation conjointe patrons-agriculteurs ? C'est un retour au sans-culottisme de la fin du 18ème siècle. Le sans-culottisme est un mouvement petit-bourgeois citadin, essentiellement parisien. Selon Albert Soboul (Les Sans-culottes parisiens de l'an II, Ed du Seuil, 1968), 45,3% des Sans-culottes sont des maîtres artisans, 18,5% sont des commerçants, 10,5% sont des professions libérales. Une bonne partie d'entre eux emploient des ouvriers.
Les Sans-culottes voyaient dans le clergé une proie, dans l'aristocratie un adversaire et dans la paysannerie une menace. Durant cette période, les biens du clergé ont été ravagés ou volés. Les patrimoines fonciers ont fait l'objet de batailles sans merci entre les nobles et les bourgeois. Ces derniers voulaient contrôler les paysans à la place des hobereaux. La liberté du paysan était vécue comme un risque de famine. Elle est aujourd'hui vécue comme une menace au confort, à la santé et au bien-être.
La dénonciation conjointe des patrons et des agriculteurs reprend la dénonciation des «accapareurs» et des paysans-chouans. Ces derniers étaient considérés comme arriérés, esclaves de leurs maîtres, contre-révolutionnaires. Il suffit de lire des ouvrages comme «Une blessure française» de Pierre Péan, pour s'apercevoir que ce mythe du chouan ne correspond pas à la réalité. Dans la région nantaise, les «bleus» étaient les bourgeois citadins, volontiers esclavagistes. Ils étaient les maîtres du commerce ; ils convoitaient la propriété foncière et industrielle. Ils se sont attaqués aux aristocrates locaux, mais aussi au peuple miséreux des campagnes, qui ne voulait pas d'eux.
Le nouveau sans-culottisme prend, assez étonnamment, bien des caractères de l'ancien.
Il veut déraciner les populations locales en créant des régions artificielles. Les Jacobins ont créé des départements sans lien avec les anciennes communautés humaines.
Il est volontiers paranoïaque. Tout le monde est suspect. La bureaucratie soupçonneuse devient la norme administrative.
Le Sans-culotte se croit porteur d'une mission universelle. Aujourd'hui, la préservation de la planète s'accompagne d'un prophétisme de bazar.
Cette régression du socialisme à un républicanisme du 18ème siècle est sensible depuis une vingtaine d'années. Elle est portée par l'écologisme parisien et les partis de la gauche hexagonale, à l'exception notable du NPA.
Retour vers le passé ? Retour vers la glorieuse Révolution française ? Non.
Le vieux barbu, qui avait le sens de l'observation, l'a bien dit : «L'histoire se répète toujours deux fois ; la première comme une tragédie, la seconde comme une farce». Nous n'avons pas en face de nous des Robespierre, mais des petits bourgeois qui tirent profit d'une république centralisée et bureaucratisée. Ces bobos, dont l'égoïsme transpire sous leur anti-productivisme, dénoncent les agriculteurs bretons et le mouvement des Bonnets rouges, de la même façon que les Sans-culottes dénonçaient les Chouans.
Ils se trompent d'époque.
Jean Pierre Le Mat
■Peut-etre que l'anti-productiviste que vous décrivez existe mais vous n'avez à mon avis pas saisi qu'il existe aussi des anti-productivistes non nostalgiques de je ne sais quelle époque, pas forcément influencés par je ne sais quel parti parisien mais plutôt inspirés par la Bretagne actuelle et surtout ne culpabilisant pas les paysans en tant que personnes mais plutôt le système qui les pousse à ce type d'agriculture.
Il faut effectivement prendre conscience qu'on a changé d'époque. Aujourd'hui, alors que ce n'ait pas le cas durant les trente glorieuses, la plupart des bretons pourrait disposer de conditions de vie matérielles qui pourraient être suffisantes si leur répartition était mieux établie. La quantité de nouriture produite est suffisante pour nourir tout les monde, il y a suffisanment de voitures pour se déplacer, de routes pour circuler. Il est évident qu'il n'est pas nécessaire de continuer à augmenter sans cesse certaines productions car d'une part on n'en aura pas besoin au niveau de notre pays et d'autre part, cela pourrait être nuisible si l'on exploite trop les ressources naturelles et notre environnement s'en retrouverait dégradé.
Ainsi, il semble préférable de contenir ce que nous produisons à ce que nous avons besoin de consommer. Nous pourrions alors nous consacrer à l'amélioration qualitative de nos produits. Diminuer les intrants chimiques améliorerait la qualité des aliments par exemple tout en évitant la pollution des l'eau et des sols et éventuellement permettrait de créer de l'emploi. Vous me direz que ces produits seront plus chers sur les marchés. Dans ce cas subventionnons les avec les produits issus de la taxation de engrais chimiques ou pesticides.
Par ailleurs, lorsque vous évoquez les fruits de la croissance dont tout le monde souhaiterait bénéficier, parlez-vous des coûts de la dépollution de l'eau de nos rivières pour la rendre potable?
Lorsque vous évoquer les charges de la décroissance que personne ne voudrait, parlez-vous de la diminution du temps de travail? Connaissez-vous beaucoup de gens par exemple qui renonceraient à leur RTT (pour ceux qui en bénéficient bien-sûr) sans augmentation de salaire?
Je pense donc qu'on peut souhaiter limiter nos productions en quantité, en améliorer la qualité pour notre bonne santé et celle de la Terre, organiser notre territoire de façon cohérente en produisant près des lieux d'habitations et répartir le travail et les revenus entre tous pour plus d'harmonie dans la société.
L'avenir c'est donc de changer nos recettes pour produire toujours plus (recette qui était d'ailleurs sûrement nécesaire à son époque et qui a bien fonctionné) et de faire en sorte que l'on produise local et de qualité ce qu'on a besoin autour de nous et bien-sûr que l'on vive bien de ce travail.
A galon,
Premièrement (contrairement à ce que pensaient les économistes du temps de Ricardo) le fait (considéré comme une évidence par la plupart des économistes contemporains) que s'il y a bien de nombreuses personnes qui sont mues par la maximisation de l'intérêt personnel, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et même parmi ceux là, l'intérêt personnel n'est pas pour tous synonyme d'intérêt financier. Et même parmi ceux là, la recherche de l'intérêt financier ne se traduit pas toujours en productivisme.
Deuxièmement le fait que le productivisme est l'idéologie (ben oui, un -isme c'est une idéologie) selon laquelle il est bon d'augmenter la productivité (et pas forcément la production). Or produire le nécessaire (et même l'utile) ne nécessite en réalité que peu de travail humain (on considère aujourd'hui que même nos ancêtres chasseurs-cueilleurs n'y consacraient pas plus de trois ou quatre heures par jour, et on sait que les paysans du moyen âge ne travaillaient guère plus de 200 jours par an) et, en fait, de moins en moins (depuis certainement un siècle, et probablement plusieurs millénaires). Donc augmenter la productivité ne peut amener que deux choses, ensemble ou séparément : d'une part (si on augmente en même temps la production) la production croissante de biens inutiles, nuisibles, polluants et le gaspillage de ressources limitées, d'autre part (si on n'augmente pas suffisamment la production) la diminution de la masse laborieuse. Le productivisme implique donc soit une augmentation exponentielle des inégalités, soit la dégradation rapide de l'environnement, soit la nécessité du partage des richesses, et plus sûrement les trois à la fois.
Troisièmement le fait que la cible des anti-productivistes soit plus le système productiviste lui même qui se traduit par de moins en moins d'agriculteurs, de plus en plus pris à la gorge par les banques et les centrales d'achat. Le productivisme a pour conséquence inéluctable d'éliminer la race des paysans.
Quatrièmement et en conséquence du deuxièmement et du troisièmement, le fait que dans la phrase conclusive «Ils se trompent d'époque», «ils» désigne les productivistes de bonne foi. Quant aux productivistes de mauvaise foi, ils se trompent tout court.
@ Paul Chérel. Je ne crois pas qu'on puisse se limiter à 2 catégories, les profiteurs et les exploités. Dans «les luttes de classes en France», Marx distinguait 7 classes sociales, dont les agriculteurs et la petite bourgeoisie. La question sous-tendue à mon article est : Outre la lutte de classes entre le prolétariat et les capitalistes, y a t'il émergence d'autres luttes de classes ,
@Divi Kerneis. Je n'ai pas parlé de nostalgie pour la Révolution française, mais de retour à des affrontements qui existaient alors. Les perspectives que vous indiquez sont pertinentes, et on ne peut qu'y adhérer. Le problème est le suivant : peut-on faire supporter à une seule catégorie de travailleurs (les tâcherons, dont les agriculteurs) les inconvénients de la mutation ? Et comment répartir la charge de cette mutation à toute la société ? l'accusation de productivisme me semble contenir une dénonciation de coupables (qui doivent donc payer), la position de dénonciateur étant celle de la victime innocente, qui est une posture d'irresponsabilité.
@ Michel Roudot. Le productivisme n'est pas une idéologie (comme le communautarisme), car personne ne s'en réclame. En revanche l'anti-productivisme, comme l'anti-communautarisme, est une position idéologique. Les penseurs socialistes d'autrefois ont certes beaucoup de défauts, mais ils tendaient vers une vision globale de la société. Ce que je reproche à l'anti-productivisme, c'est une vision limitée, partielle et partiale. Il n'existe pas de «système productiviste». L'augmentation de production et de productivité fait partie d'une logique plus large. Se limiter au productivisme me semble une erreur.
Michel je me permets de recopier ce que vous avez écrit ,alors sur le principe ,vous avez globalement raison Mais en réalité les choses ne sont pas si simples. Le problème est aujourd'hui davantage d'ordre sociologique qu'économique ,surtout dans le domaine de l'élevage qui concerne une grande partie de l'agriculture bretonne L'exploitation familiale est en fait remise en cause aujourd'hui ,non pas par ce qu'elle n'est pas compétitive par rapport à d'autres modèles ,mais par un problème d'adaptation des agriculteurs à la société moderne et celle des loisirs ,ce sont souvent les femmes qui contribuent à amplifier ce fait de société
Par contre signe des temps ? le pays qui était précurseur des grandes unités de productions ,souvent industrielles ,semble faire marche arrière ,je veux parler des USA ou d'une part les exploitations moyennes (ce seraient des grandes ici) sont aidées davantage ,et les conjointes incitées aussi financièrement à rester sur l'exploitation
D'autre par beaucoup de petites exploitations(moins de 5 HA ) apparaissent en circuit court du fait que il existe une forte demande de sécurité alimentaire liée, et c'est surprenant,principalement au risque terroriste ,d'autre part ce type d'installation est abordable financièrement pour des personnes qui n'ont pas les moyens d'investir dans de grosses unités
Cette mutation (sortir du productivisme pour établir un monde vivable à terme) engendrera effetivement des coûts pour cetains. Toutefois, ce n'est à mon avis pas à l'ensemble de la société de payer, et surtout pas les plus faibles ou ceux qui sont déjà appauvris par ce système ou qui ont du s'endêter pour s'en sortir. En revanche, c'est particulièrement à ceux qui bénéficient du productivisme actuel (certaines coopératives, grande distribution, vendeurs de produits chimiques) d'y contribuer d'avantage.
Le productivisme reposant par ailleurs sur la mondialisation (ou l'engendrant), c'est-à-dire sur sur le fait d'exporter et donc d'avoir à accepter d'importer en compensation, ce qui concurrence les produits locaux, il me semble évident de devoir limiter ou enchérer ces importations.
Un système de taxation s'imose donc. Il me semblerait donc logique de taxer d'avantage un produit venant de loin (et souvent de pays dont les protections sociales pour les travailleurs sont moindres). Ces recettes permettraient de soutenir une production locale de qualité et les emplois qui vont avec.
Sans vouloir réssuciter l'éco-taxe qui était mal conçue et qui aurait pénalisée notre péninsule, un système de taxation aux frontières ou au km me parrait indispensable si l'on souhaite contruire un monde qui nous permettra et qui permettra à nos descendants de bien vivre au pays.
Voir le site